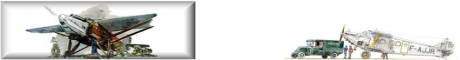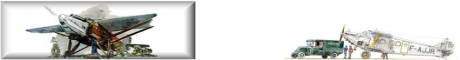| Histoire
|
Récit de Gaston Tissandier :
Le premier départ aérien s'exécuta le 23 septembre; Jules Duruof s'élève en
ballon du la place Saint-Pierre à 8 heures du matin. Deux aérostats le suivent
dans les airs, le 25 et le 26 du même mois. Mon frère et moi, qui avons fait,
les années précédentes, un grand nombre d'ascensions en artistes et en amateurs,
nous offrons nos services à M. Rampont. Paris, disons-nous, peut perdre deux
soldats pour gagner deux courriers aériens. Les gardes nationaux ne manquent pas
ici, mais les aéronautes sont rares.
Le jour même du départ de Louis Godard, un des administrateurs de la Poste
m'appelle auprès de lui.
--Vous êtes prêt à partir en ballon, me dit-il.
--Quand vous voudrez.
--Eh bien! nous comptons sur vous demain matin à 6 heures, à l'usine de
Vaugirard; votre ballon sera gonflé, nous vous confierons nos lettres et nos
dépêches.
Le 30 septembre, à 5 heures du matin, je pars de chez moi avec mes deux
frères qui m'accompagnent. J'arrive à l'usine de Vaugirard, mon ballon est
gisant à terre comme une vieille loque de chiffons. C'est le Céleste, un
petit aérostat de 700 mètres cubes, que son propriétaire a généreusement offert
au génie militaire. Pour moi c'est presque'un ami, je le connais de longue date;
il a failli me rompre les os, l'année précédente. Je le regarde avec soin, je le
touche respectueusement, et je m'aperçois, hélas! qu'il est dans un état
déplorable. Il a gelé la nuit; le froid l'a saisi, son étoffe est raide et
cassante. Grand Dieu! qu'aperçois-je près de la soupape? des trous où l'on
passerait le petit doigt, ils sont entourés de toute une constellation de
piqûres. Ceci n'est plus un ballon, c'est une écumoire.
Cependant les aéronautes qui doivent gonfler mon navire aérien, arrivent. Ils
ont avec eux une bonne couturière qui, armée de son aiguille, répare les
avaries. Mon frère prend un pot de colle, un pinceau, et applique des
bandelettes de papier sur tous les petits trous qui s'offrent à son
investigation minutieuse. C'est égal, je ne suis que médiocrement rassuré, je
vais partir seul dans ce méchant ballon, usé par l'âge et le service; j'entends
le canon qui tonne à nos portes; mon imagination me montre les Prussiens qui
m'attendent, les fusils qui se dressent et vomissent sur mon navire aérien une
pluie de balles!
La dernière fois que je suis monté dans le Céleste, je n'ai pu rester
en l'air que trente-cinq minutes! Toutes les perspectives qui s'ouvrent à mes
yeux ne sont pas très-rassurantes.
--Ne partez pas, me disent des amis, attendez au moins un bon ballon; c'est
folie de s'aventurer ainsi dans un outil de pacotille.
Cependant, MM. Bechet et Chassinat arrivent de la Poste avec des ballots de
lettres. M. Hervé Mangon me dit que le vent est très-favorable, qu'il souffle de
l'est et que je vais descendre en Normandie; le colonel Usquin me serre la main
et me souhaite bon succès. Puis bientôt M. Ernest Picard, à qui je suis
spécialement recommandé, demande à m'entretenir; pendant une heure, il m'informe
des recommandations que j'aurai à faire à Tours au nom du gouvernement de Paris;
il me remet un petit paquet de lettres importantes que je devrai, dit-il, avaler
ou brûler en cas de danger. Sur ces entrefaites, le soleil se lève, et le ballon
se gonfle. Ma foi, le sort en est jeté. Pas d'hésitations! Mon frère surveille
toujours la réparation du ballon, il bouche les trous avec une attention dont il
ne se sentirait pas capable, s'il travaillait pour lui-même: la besogne qu'il
exécute si bien, me rassure. Il est certain que je préférerais un bon ballon,
tout frais verni et tout neuf, mais je me suis toujours persuadé qu'il y avait
un Dieu pour les aéronautes. Je me laisse conduire par ma destinée, les yeux
bien ouverts, le coeur et les bras résolus. Je ne puis m'empêcher de penser à
mon dernier voyage aérien. C'était le 27 juin 1869, au milieu du Champ de Mars.
Je partais avec huit voyageurs dans l'immense ballon le Pôle Nord. Qui
aurait pu soupçonner, alors, la nécessité future des ballons-poste!
A 9 heures, le ballon est gonflé, on attache la nacelle. J'y entasse des sacs
de lest et trois ballots de dépêches pesant 80 kilog.
On m'apporte une cage contenant trois pigeons.
--Tenez, me dit Van Roosebeke, chargé du service de ces précieux messagers,
ayez bien soin de mes oiseaux. A la descente, vous leur donnerez à boire, vous
leur servirez quelques grains de blé. Quand ils auront bien mangé, vous en
lancerez deux, après avoir attaché à une plume de leur queue la dépêche qui nous
annoncera votre heureuse descente. Quant au troisième pigeon, celui ci qui a la tête brune, c'est un vieux malin que je ne donnerais pas pour cinq cents francs.
Il a déjà fait de grands voyages. Vous le porterez à Tours. Ayez-en bien soin.
Prenez garde qu'il ne se fatigue en chemin de fer.
Je monte dans la nacelle au moment où le canon gronde avec une violence extrême. J'embrasse mes frères, mes amis. Je pense à nos soldats qui combattent
et qui meurent à deux pas de moi. L'idée de la patrie en danger remplit mon âme.
On attend là-bas ces ballots de dépêches qui me sont confiés. Le moment est grave et solennel; nul sentiment d'émotion ne saurait plus m'atteindre. Lâchez tout!
Me voilà flottant au milieu de l'air! * * * * *
Mon ballon s'élève dans l'espace avec une force ascensionnelle très-modérée.
Je ne quitte pas de vue l'usine de Vaugirard et le groupe d'amis qui me saluent de la main: je leur réponds de loin en agitant mon chapeau avec enthousiasme, mais bientôt l'horizon s'élargit. Paris immense, solennel, s'étend à mes pieds, les bastions des fortifications l'entourent comme un chapelet; là, près de Vaugirard, j'aperçois la fumée de la canonnade, dont le grondement sourd et
puissant, tout à la fois, monte jusqu'à mes oreilles comme un concert lugubre.
Les forts d'Issy et de Vanves m'apparaissent comme des forteresses en miniature; bientôt je passe au-dessus de la Seine, en vue de l'île de Billancourt.
Il est 9 heures 50; je plane à 1,000 mètres de haut; mes yeux ne se détachent
pas de la campagne, où j'aperçois un spectacle navrant qui ne s'effacera jamais de mon esprit. Ce ne sont plus ces environs de Paris, riants et animés, ce n'est plus la Seine, dont les bateaux sillonnent l'onde, où les canotiers agitent
leurs avirons. C'est un désert, triste, dénudé, horrible. Pas un habitant sur
les routes, pas une voiture, pas un convoi de chemin de fer. Tous les ponts
détruits offrent l'aspect de ruines abandonnées, pas un canot sur la Seine qui déroule toujours son onde au milieu des campagnes, mais avec tristesse et
monotonie. Pas un soldat, pas une sentinelle, rien, rien, l'abandon du
cimetière. On se croirait aux abords d'une ville antique, détruite par le temps;
il faut forcer son souvenir pour entrevoir par la pensée les deux millions
d'hommes emprisonnés près de là dans une vaste muraille!
LE CÉLESTE
Il est dix heures; le soleil est ardent et donne des ailes à mon ballon; le
gaz contenu dans le Céleste se dilate sous l'action de la chaleur; il
sort avec rapidité par l'appendice ouvert au-dessus de ma tête, et m'incommode
momentanément par son odeur. J'entends un léger roucoulement au-dessus de moi. Ce sont mes pigeons qui gémissent. Ils ne paraissent nullement rassurés et me
regardent avec inquiétude.
--Pauvres oiseaux, vous êtes mes seuls compagnons; aéronautes improvisés, vous allez défier tous les marins de l'air, car vos ailes vous dirigeront bientôt vers Paris, que vous quittez, et nos ballons sauront-ils y revenir? L'aiguille de mon baromètre Breguet tourne assez vite autour de son cadran, elle m'indique que je monte toujours..., puis elle s'arrête au point qui correspond à une altitude de 4,800 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Il fait ici une chaleur vraiment insupportable: le soleil me lance ses rayons en pleine figure et me brûle; je me désaltère d'un peu d'eau. Je retire mon paletot, je m'assieds sur mes sacs de dépêches, et le coude appuyé sur le bord de la nacelle, je contemple en silence l'admirable panorama qui s'étale devant moi.
Le ciel est d'un bleu indigo; sa limpidité, son ton chaud, coloré, me
feraient croire que je suis en Italie; de beaux nuages argentés planent
au-dessus des campagnes; quelques-uns d'entre eux sont si loin de moi, qu'ils
paraissent mollement se reposer au-dessus des arbres. Pendant quelques instants, je m'abandonne à une douce rêverie, à une muette contemplation, charme merveilleux des voyages aériens: je plane dans un pays enchanté, monde abandonné
de tout être vivant, le seul où la guerre n'ait pas encore porté ses maux! Mais
la vue de Saint-Cloud que j'aperçois à mes pieds, sur l'autre rive de la Seine,
me ramène aux choses d'en bas. Je me reporte vers la réalité, vers l'invasion.
Je jette mes regards du côté de Paris, que je n'entrevois plus que sous une
mousseline de brume.
Une profonde tristesse s'empare de moi; j'éprouve la sensation du marin qui
quitte le port pour un long voyage. Je pars; mais quand reviendrai-je? Je te
quitte, Paris; te retrouverai-je? Comment définir ces pensées qui se heurtent
confusément dans mon cerveau? C'est là-bas, au milieu de ce monceau de
constructions, de ce labyrinthe de rues et de boulevards, que j'ai vu le jour;
c'est sous cette mer de brume que s'est écoulée mon enfance! C'est toi, Paris,
qui as su ouvrir mon coeur aux sentiments d'indépendance et de liberté qui m'animent! Te voilà captif aujourd'hui? L'heure de la délivrance sonnera-t-elle pour toi? Je sais bien que la foi, la constance, ne manqueront jamais à tes enfants; mais qui peut compter sans les hasards de la guerre?
Pendant que mille réflexions naissent et s'agitent ainsi dans mon esprit, le vent me pousse toujours dans la direction de l'Ouest, comme l'atteste ma boussole. Après Saint-Cloud, c'est Versailles qui étale à mes yeux les
merveilles de ses monuments et de ses jardins.
Jusqu'ici je n'ai vu que déserts et solitudes, mais au-dessus du parc la
scène change. Ce sont des Prussiens que j'aperçois sous la nacelle. Je suis à
1,600 mètres de haut; aucune balle ne saurait m'atteindre. Je puis donc m'armer d'une lunette et observer attentivement ces soldats, lilliputiens vus de si haut.
Je vois sortir de Trianon des officiers qui me visent avec des lorgnettes,
ils me regardent longtemps; un certain mouvement se produit de toutes parts. Des Prussiens se chauffent le ventre sur le tapis vert, sur cette pelouse que
foulait aux pieds Louis XIV. Ils se lèvent, et dressent la tête vers le
Céleste. Quelle joie j'éprouve en pensant à leur dépit.--Voilà des
lettres que vous n'arrêterez pas, et des dépêches que vous ne pourrez lire! Mais
je me rappelle au même moment qu'il m'a été remis 10,000 proclamations imprimées en allemand à l'adresse de l'armée ennemie.
J'en empoigne une centaine que je lance par dessus bord; je les vois voltiger dans l'air en revenant lentement à terre; j'en jette à plusieurs reprises un
millier environ, gardant le reste de ma provision pour les autres Prussiens que
je pourrai rencontrer sur ma route.
Que contenait cette proclamation? Quelques paroles simples disant à l'armée allemande que nous n'avions plus chez nous ni empereur, ni roi, et que s'ils avaient le bon sens de nous imiter, on ne se tuerait plus inutilement comme des bêtes sauvages. Paroles sensées, mais jetées au vent, emportées par la brise comme elles sont venues!
Le Céleste se maintient à 1,600 mètres d'altitude; je n'ai pas à jeter une pincée de lest, tant le soleil est ardent; car il n'est pas douteux que mon
ballon fuit, et, sans la chaleur exceptionnelle de l'atmosphère, mon mauvais
navire n'aurait pas été long à descendre avec rapidité, et peut-être au milieu
des Prussiens. En quittant Versailles, je plane au-dessus d'un petit bois dont
j'ignore le nom et l'exacte position. Tous les arbres sont abattus au milieu du
fourré; le sol est aplani, une double rangée de tentes se dressent des deux
côtés de ce parallélogramme. A peine le ballon passe-t-il au-dessus de ce camp,
j'aperçois les soldats qui s'alignent; je vois briller de loin les baïonnettes;
les fusils se lèvent et vomissent l'éclair au milieu d'un nuage de fumée.
Ce n'est que quelques secondes après que j'entends au-dessous de la nacelle
le bruit des balles et la détonation des armes à feu. Après, cette première
fusillade, c'en est une autre qui m'est adressée, et ainsi de suite jusqu'à ce
que le vent m'ait chassé de ces parages inhospitaliers. Pour toute réponse, je
lance à mes agresseurs une véritable pluie de proclamations.
C'est un panorama toujours nouveau qui se déroule aux yeux de l'aéronaute;
suspendu dans l'immensité de l'espace, la terre se creuse sous la nacelle comme
une vaste cuvette dont les bords se confondent au loin avec la voûte céleste. On
n'a pas le loisir de contempler longtemps le même paysage quand le vent est
rapide; si le puissant aquilon vous entraîne, la scène terrestre est toujours
nouvelle, toujours changeante. Je ne tarde pas à voir disparaître les Prussiens
qui ont perdu leur poudre contre moi: d'autres tableaux m'attendent. J'aperçois
une forêt vers laquelle je m'avance assez rapidement. Je ne suis pas sans une
certaine inquiétude, car le Céleste commence à descendre; je jette du
lest poignée par poignée, et ma provision n'est pas très-abondante. Cependant je
ne dois pas être bien éloigné de Paris. L'accueil que m'a fait l'ennemi en
passant au-dessus d'un de ses camps ne me donne nulle envie de descendre chez
lui.
J'ai toujours remarqué, non sans surprise, que l'aéronaute, même à une assez
grande hauteur, subit d'une façon très-appréciable l'influence du terrain
au-dessus duquel il navigue. S'il plane au-dessus des déserts de craie de la
Champagne, il sent un effet de chaleur intense, les rayons solaires sont
réfléchis jusqu'à lui; il est comme un promeneur qui passerait au soleil devant
un mur blanc. S'il trace, en l'air, son sillage au-dessus d'une forêt, le
voyageur aérien est brusquement saisi d'une impression de fraîcheur étonnante,
comme s'il entrait, en été, dans une cave.--C'est ce que j'éprouve à 10 heures
45 en passant à 1420 mètres au-dessus des arbres, que je ne tarde pas à
reconnaître pour être ceux de la forêt d'Houdan.--Ma boussole et ma carte ne me
permettent aucun doute à cet égard. Mais ce froid que je ressens, après une
insolation brûlante, le gaz en subit comme moi l'influence; il se refroidit, se
contracte, l'aérostat pique une tête vers la forêt; on dirait que les arbres
l'appellent à lui. Comme l'oiseau, le Céleste voudrait-il aller se poser sur les
branches?
Je me jette sur un sac de lest, que je vide par dessus bord, mais mon
baromètre m'indique que je descends toujours; le froid me pénètre jusqu'aux os.
Voilà le ballon qui atteint rapidement les altitudes de 1000 mètres, de 800
mètres, de 600 mètres. Il descend encore. Je vide successivement trois sacs de
lest, pour maintenir mon aérostat à 500 mètres seulement au-dessus de la forêt,
car il se refuse à monter plus haut!
A ce moment, je plane au-dessus d'un carrefour. Un groupe d'hommes s'y trouve
rassemblé; grand Dieu! ce sont des Prussiens. En voici d'autres plus loin; voici
des uhlans, des cavaliers qui accourent par les chemins. Je n'ai plus qu'un sac
de lest. Je lance dans l'espace mon dernier paquet de proclamations. Mais le
ballon a perdu beaucoup de gaz, par la dilatation solaire, par ses fuites, il
est refroidi, sa force ascensionnelle est terriblement diminuée. Je ne suis qu'à
une hauteur de 420 mètres, une balle pourrait bien m'atteindre.
Je regarde attentivement sous mes pas. Si un soldat lève son fusil vers moi,
je lui jette sur la tête tout un ballot de lettres de 40 kilogrammes; mon navire
aérien allégé de ce poids retrouvera bien ses ailes. Malgré mon vif désir de
remplir ma mission, je n'hésiterai pas à perdre mes dépêches pour sauver ma
vie.
Heureusement pour moi le vent est vif; je file comme la flèche au-dessus des
arbres; les uhlans me regardent étonnés, et me voient passer, sans qu'une seule
balle m'ait menacé. Je continue ma route au-dessus de prairies verdoyantes,
gracieusement encadrées de haies d'aubépine.
Il est bientôt midi, je passe assez près de terre; les spectateurs qui me
regardent sont bel et bien, cette fois, des paysans français, en sabots et en
blouse. Ils lèvent les bras vers moi, on dirait qu'ils m'appellent à eux; mais
je suis encore bien près de la forêt, je préfère prolonger mon voyage le plus
longtemps possible. Je me contente de lancer dans l'espace quelques exemplaires
d'un journal de Paris que son directeur m'a envoyés au moment de mon départ. Je
vois les paysans courir après ces journaux, qui se sont ouverts dans leur chute,
et voltigent comme de grandes feuilles emportées par le vent.
Une petite ville apparaît bientôt à l'horizon. C'est Dreux avec sa grande
tour carrée. Le Céleste descend, je le laisse revenir vers le sol. Voilà
une nuée d'habitants qui accourent. Je me penche vers eux et je crie de toute la
force de mes poumons:
--Y a-t-il des Prussiens par ici? Mille voix me répondent en choeur:
--Non, non, descendez!
Je ne suis plus qu'à 50 mètres de terre, mon guide-rope rase les champs, mais
un coup de vent me saisit, et me lance subitement coutre un monticule. Le ballon
se penche, je reçois un choc terrible, qui me fait éprouver une vive douleur, ma
nacelle se trouve tellement renversée que ma tête se cogne contre
terre.--M'apercevant que je descendais trop vite je me suis jeté sur mon dernier
sac de lest; dans ce mouvement le couteau que je tenais pour couper les liens
qui servent à enrouler la corde d'ancre s'est échappé de mes mains, de sorte
qu'en voulant faire deux choses à la fois j'ai manqué toute la manoeuvre. Mais
je n'ai pas le loisir de méditer sur l'inconvénient d'être seul en ballon. Le
Céleste, après ce choc violent, bondit à 60 mètres de haut, puis il
retombe lourdement à terre, cette fois j'ai pu réussir à lancer l'ancre, à
saisir la corde de soupape. L'aérostat est arrêté; les habitants de Dreux
accourent en foule, j'ai un bras foulé, une bosse à la tête, mais je descends du
ciel en pays ami!
Ah! quelle joie j'éprouve à serrer la main à tous ces braves gens qui
m'entourent. Ils me pressent de questions.--Que devient Paris? Que pense-t-on à
Paris? Paris résistera-t-il? Je réponds de mon mieux à ces mille demandes qu'on
m'adresse de toutes parts.--Je prononce un petit discours bien senti qui excite
un certain enthousiasme.--Oui, Paris tiendra tête à l'ennemi. Ce n'est pas chez
cette vaillante population que l'on trouvera jamais découragement ou faiblesse,
on n'y verra toujours que ténacité et vaillance. Que la province imite la
capitale, et la France est sauvée!
Je dégonfle à la hâte le Céleste, faisant écarter la foule par
quelques gardes nationaux accourus en toute hâte. Une voiture vient me prendre,
m'enlève avec mes sacs de dépêches et ma cage de pigeons. Les pauvres oiseaux
immobiles ne sont pas encore remis de leurs émotions!
En descendant sur la place, plus de cinquante personnes m'invitent à
déjeuner, mais j'ai déjà accepté l'hospitalité que m'a gracieusement offerte le
propriétaire de la voiture. Mon hôte a lu par hasard mon nom sur ma valise, il a
reconnu en moi un des voisins de son associé de la rue Bleue. Je mange gaiement,
avec appétit, et je me fais conduire au bureau de poste avec mes sacs de lettres
parisiennes.
Je les pose à terre, et je ne puis m'empêcher de les contempler avec émotion.
Il y a sous mes yeux trente mille lettres de Paris. Trente mille familles vont
penser au ballon qui leur a apporté au-dessus des nuages la missive de
l'assiégé!
Que de larmes de joie enfermées dans ces ballots! Que de romans, que
d'histoires, que de drames peut-être, sont cachés sous l'enveloppe grossière du
sac de la poste!
Le directeur du bureau de poste entre, et parait stupéfait de la besogne que
je lui apporte. Je vois son commis qui ouvre des yeux énormes en pensant aux
trente mille coups de timbre humide qu'il va frapper. Il n'a jamais à Dreux été
à pareille fête. On en sera quitte pour prendre un supplément d'employés; mais
la besogne marchera vite: le directeur me l'assure. Quant au petit sac officiel,
je vais le porter moi-même à Tours, par un train spécial que je demande par
télégramme.
Qu'ai-je à faire maintenant? A lancer mes pigeons pour apprendre à mes amis
que je suis encore de ce monde, et pour annoncer que mes dépêches sont en lieu
sûr. Je cours à la sous-préfecture, où j'ai envoyé mes messagers ailés. On leur
a donné du blé et de l'eau, ils agitent leurs ailes dans leur cage. J'en saisis
un qui se laisse prendre sans remuer. Je lui attache à une plume de la queue ma
petite missive écrite sur papier fin. Je le lâche; il vient se poser à mes
pieds, sur le sable d'une allée. Je renouvelle la même opération pour le second
pigeon, qui va se placera côté de son compagnon. Nous les observons
attentivement. Quelques secondes se passent. Tout à coup les deux pigeons
battent de l'aile et bondissent d'un trait à 100 mètres de haut. Là, ils planent
et s'orientent de la tête, ils se tournent vivement vers tous les points de
l'horizon, leur bec oscille comme l'aiguille d'une boussole, cherchant un pôle
mystérieux. Les voilà bientôt qui ont reconnu leur route, ils filent comme des
flèches... en droite ligne dans la direction de Paris!
Pour compléter les informations relatives à la quatrième ascension du 30
septembre, je donne le texte des proclamations que j'ai jetées au nombre de
10,000 sur la tête des Prussiens.
Chaque proclamation était imprimée en deux colonnes sur une feuille de papier
format in-8°. La colonne de gauche était imprimée en texte allemand, celle de
droite était la traduction française de ce document.
TEXTE FRANÇAIS DES PROCLAMATIONS LANCÉES EN BALLON SUR LES CAMPS
PRUSSIENS.
«Au commencement de la guerre, la nation allemande a pu croire que la nation
française encourageait l'Empereur Napoléon III dans ses projets d'agression.
«La nation allemande a pu se convaincre depuis la chute de l'Empereur que la
nation française veut la paix. Elle désire vivre unie avec l'Allemagne, sans
contrarier son mouvement d'unité, qui profitera aux deux peuples.
«Il semblerait d'abord naturel que les deux nations missent bas les armes et
cessassent de s'entre-tuer. «La France a reconnu qu'elle était responsable des
fautes de son gouvernement. Elle a déclaré être prête à réparer les maux que ce
gouvernement a faits.
«L'Allemagne laissée à elle-même accepterait de grand coeur ces conditions
honorables. Elle a montré sa vaillance et sa science militaires. Elle n'a aucun
intérêt à continuer cette lutte qui la ruine et lui enlève ses plus glorieux
enfants.
«Mais l'Allemagne n'est pas libre.
«Elle est dominée par la Prusse, et la Prusse elle-même est sous la main d'un
monarque et d'un ministre ambitieux.
«Ce sont ces deux hommes qui ont repoussé la paix qu'on leur offrait. Ils
veulent satisfaire leur vanité en enlevant Paris. Paris résistera jusqu'à la
dernière extrémité; Paris peut être le tombeau de l'armée assiégeante.
«Dans tous les cas, le siège sera long; voici l'Allemagne hors de chez elle
tout l'hiver, et l'absence de la fleur de la population laisse les familles dans
la misère.
«Jusques à quand les peuples seront-ils la dupe de ceux qui les gouvernent?
Ce sont les rois et leurs ministres qui les poussent les uns contre les autres à
des a combats homicides. Commandée par Napoléon, la France marchait à la
bataille; maintenant que Napoléon est renversé, elle ouvre les bras à
l'Allemagne. Sans doute elle défendra pied à pied son foyer, elle ne se laissera
rien enlever de son sol; mais aussi elle prend l'engagement de respecter celui
de ses voisins. Elle leur propose une alliance fraternelle. Que l'Allemagne ne
soit pas plus longtemps l'esclave d'une ambition aveugle; qu'elle ne lui donne
plus ses enfants à égorger.»
On a renoncé à ces proclamations qui ne produisaient sans doute pas grand
effet sur les Allemands. Il parait en outre que des paysans français, en ayant
ramassé quelques-unes, avaient cru qu'elles étaient lancées par un ballon
prussien; ils se seraient empressés de tirer des coups de fusil sur l'aérostat.
|