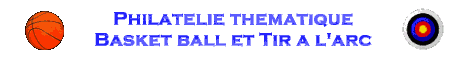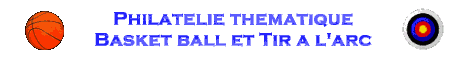|
Vendre, Acheter, Echanger
|
|
|
|
 |
 |
Luc-Olivier Merson : Mosaïques du Sacré-Coeur de Montmartre

Cul-de-four du choeur, Sacré-Coeur de Montmartre
(18e) Place du Parvis du Sacré-Coeur - Lucien et Henri-Marcel Magne, Luc-Olivier Merson et Marcel Imbs,
Maison Guilbert-Martin 1911-1923
La faible clarté intérieure du Sacré-Coeur est compensée par l'éclat d'un décor saturé où la mosaïque domine,
des murs (cul-de-four, coupole, panneaux muraux) au mobilier liturgique (croix de consécration, chemin de croix, bénitiers, autel).
L'architecte choisit délibérément la mosaïque au détriment de la fresque : alors très prisée, cette technique était en outre moins vulnérable
à la forte humidité des lieux. Enfin elle faisait écho à l'architecture de style romano-byzantin d'Abadie, référence à Sainte-Sophie de Constantinople,
au mausolée de Galla Placidia à Ravenne et à Saint-Marc de Venise. Sur ce chantier de l'art français, les mosaïstes italiens sont écartés au profit de
la maison Guilbert-Martin qui réalise la quasi-totalité des mosaïques d'émail et d'or.
Quatre artistes participent à la réalisation de la mosaïque du cul-de-four du choeur.
En 1911, la direction artistique en est confiée à Luc-Olivier Merson (1846-1920), le grand artiste chrétien, Prix de Rome et membre de l'Institut.
Il est aidé, pour l'exécution de la maquette et des cartons, par Lucien Magne.
Après la disparition de celui-ci en 1916 et de Merson en 1920, deux élèves de ce dernier, Henri-Marcel Magne et Marcel Imbs, prennent la suite.
Le décor n'est mis au jour qu'en novembre 1923. Le travail considérable a nécessité la réalisation de multiples esquisses et dessins préparatoires,
repris et agrandis puis transmis au mosaïste. Son équipe relève en un temps record une véritable gageure technique : en 3 mois, 5 hommes parviennent
à couvrir une surface totale de 473 mètres carrés d'un seul tenant (la tête du Christ mesure 2 mètres de haut), soit 25 000 tesselles et plus de 68 tonnes.
La mosaïque résume symboliquement l'histoire de la dévotion au Sacré-Coeur.
Au centre, un Christ monumental montre son coeur
et étend ses bras protecteurs sur le monde chrétien. Autour de lui ou à ses pieds, la Vierge, Saint Michel, le pape Léon XIII, Jeanne d'Arc et la France,
lui présentent les principaux propagateurs de ce culte, depuis les premiers martyrs jusqu'à Legentil et Rohaut de Fleury, commanditaires de la basilique.
Les réminiscences médiévales expliquent les lignes rouges festonnées compartimentant la composition, le fond bleu qui fait ressortir les couleurs vives,
la taille des personnages variant en fonction de leur importance hiérarchique, la présence matérielle
d'architectures fantaisistes enfin.
|
 |
 |
 |